Le cadre juridique devant permettre de reconnaître les Baka, les Bagyélé, les Bakola, les Bedzan, et les Bororos est en cours d’élaboration depuis 25 ans ; et parfois sans moyens de défense et de subsistance, ces populations, chassées des forêts et des savanes au nom des projets de développement, craignent d’être raillées de la carte du Cameroun.
Depuis 1994, les Nations Unies ont institué la Journée internationale des peuples autochtones (PA). Celle-ci s’observe la 9 août de chaque année. C’est en prélude à l’édition de 2025, qui a pour thème : « Peuple autochtones et intelligence artificielle : défendre les droits, façonner l’avenir » que Greenpeace Afrique a organisé, le 8 août à Yaoundé, une journée d’information et de plaidoyer dans le but de poursuivre ses actions qui visent trois objectifs principaux : « susciter la reconnaissance des peuples autochtones comme citoyens à part entière des pays du bassin du Congo, inciter à la reconnaissance de leurs droits fonciers et instaurer une journée internationale du bassin du Congo », a rappelé le Dr Fabrice Lamfu Yengong, responsable de campagne Forêts à Greenpeace Afrique. Ce dernier qui va lancer un appel en direction des administrations et des gouvernements à faire avancer le travail pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones afin qu’à la prochaine commémoration de la journée internationale à eux consacrée, en 2026, ces avancées puissent être célébrées.

L’assistance à cette activité à laquelle ont pris part des chefs traditionnels, des jeunes, des activistes et des représentants de certains ministère a eu un pincement au cœur d’apprendre qu’au Cameroun, jusqu’au 8 août 2025, il n’y a aucun cadre juridique reconnaissant les Baka, Bagyélé, Bakola et Bedzan, peuples autochtones de la forêt et les Bororo, PA de la savane. La représentante du ministère des Affaires sociales a indiqué qu’une étude a été commise en 2000 dans ce sens et les résultats restent toujours attendus. Mais, elle va rassurer que le Cameroun se sert des chartes et des conventions internationales qu’il a signées et ratifiées.
S’adapter à leur nouveau milieu de vie
Seulement, ce manque d’instruments de protection au niveau national renforce la marginalisation des PA. La représentante du ministre de l’Administration territoriale va d’ailleurs relever que le gouvernement reconnaît les chefferies traditionnelles d’autant plus que les chefs sont des auxiliaires de l’administration ; sauf qu’en attendant l’effectivité de la délimitation territoriale, les peuples autochtones sont marginalisés et elle plaide pour la prise en compte de ceux-ci par les autres. Ce qui n’est pas le cas sur le terrain « Nous avons des problèmes fonciers ; nos frères bantous nous méprisent, nous délogent de nos habitats. Nos grands-parents ont été sortis de la forêt pour la route mais ils n’ont pas su qu’il fallait se rapprocher de l’administration pour avoir la reconnaissance de leur présence en bordure de route. Aujourd’hui, nous en souffrant. La forêt est notre mère, si elle disparaît, nous allons aussi disparaître », a lancé Thaddée Kolo, jeune Baka. Son frère, Jean Jacques Ebo Ebo, de Meyomessala, dans le département du Dja et Lobo, supplie le gouvernement de reconnaître les chefferies traditionnelles des peuples autochtones.
Une question revient à chaque occasion ; si l’on les nomme premiers occupants de la forêt, comment donc comprendre qu’ils n’aient ni reconnaissance, ni chefferie, ni territoire aujourd’hui ? En guise de solution, Stella Tchoukep, la chargée de campagne Forêts à Greenpeace Afrique au propose une cartographie (avec eux) de leurs espaces de vie, des activités qu’ils mènent pour pouvoir documenter leurs droits fonciers. Elle souhaite également que les peuples autochtones puissent recevoir des moyens pour s’adapter à leur nouveau milieu de vie où ils doivent désormais vivre dans des maisons différentes des leurs, se nourrir, se soigner et se vêtir étant donné qu’ils ont été sortis de la forêt qui leur procurait gratuitement tout pour subvenir à leurs besoins.





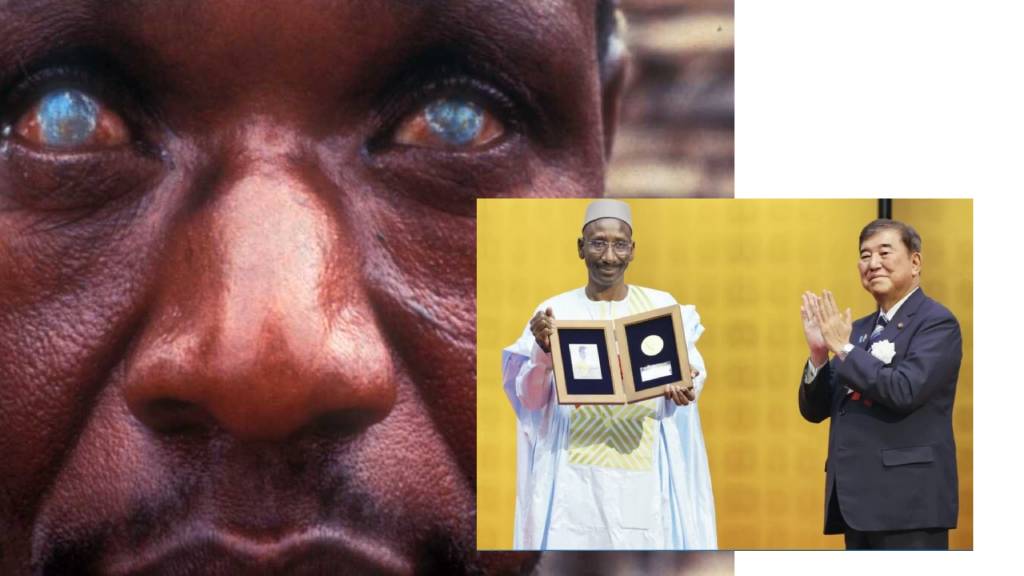













Commentaires 0